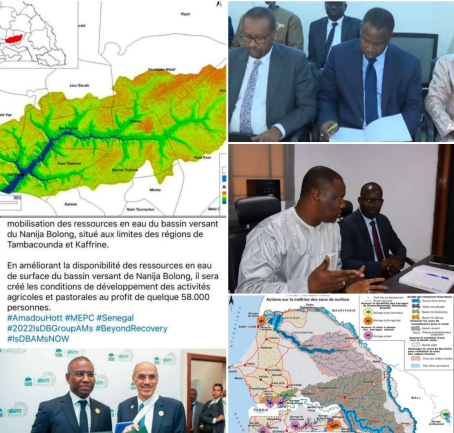Le monde vit dans un état de conflit quasi permanent. Le rapport de force s’est imposé comme une constante de l’histoire humaine. Les conflits sont à la fois civilisationnels, religieux, économiques et militaires. Pour en atténuer la brutalité et tenter d’humaniser ces affrontements, l’humanité s’est dotée d’un corpus normatif : diplomatie internationale, droit international, diplomatie militaire et économique. En théorie. Dans les faits, il ne s’agit bien souvent que d’un jeu de mots. Les grandes puissances n’ont eu de cesse de fouler aux pieds ces règles qu’elles prétendent défendre. Comment comprendre, autrement, l’attitude trumpiste sur la scène internationale ? De l’ingérence américaine au Panama en 1989 à l’infiltration de Caracas, de l’arrestation de Saddam Hussein à l’intervention française en Côte d’Ivoire, les exemples abondent. Seules les formes et les procédures opérationnelles évoluent ; le principe, lui, demeure inchangé : imposer sa force et affirmer sa domination.
Dans ce contexte mondial marqué par la brutalité des rapports de puissance, une réalité s’impose avec une froide évidence : seule la dissuasion militaire protège réellement. L’Afrique, dépourvue d’une véritable capacité dissuasive stratégique, demeure vulnérable. Aucun régime, aussi légitime soit-il, n’est à l’abri des appétits extérieurs.
Dès lors, la question mérite d’être posée sans détour : jusqu’à quand l’Afrique restera-t-elle sans arme dissuasive face à un monde qui ne respecte que la force ?
La diplomatie n’est qu’une question de rapport de forces. Peu importe les formes ou les procédures prétendument « civilisées ». Ce qui compte réellement pour les puissances, c’est d’imposer leur loi. En lisant certains articles et commentaires sur l’arrestation du président vénézuélien Nicolás Maduro, j’entends l’indignation d’innombrables observateurs face au danger que représente l’administration Trump pour l’ordre international.
Beaucoup, nourris d’un idéal strictement diplomatique, restent concentrés sur les règles du droit international. Mais, ces règles, déjà mises à mal par les grandes puissances, se heurtent aujourd’hui à la brutalité d’une nouvelle réalité géopolitique.
Sous cet angle, l’opération menée par les États-Unis à Caracas s’érige comme l’antithèse des principes qui devraient régir la diplomatie internationale. D’autant plus venant de la première puissance mondiale censée être le garant de l’équilibre mondial. Dans la nuit du 3 janvier 2026, les forces américaines ont lancé l’opération « Absolute Resolve », une action militaire complexe visant à capturer Nicolás Maduro et son épouse. Cette opération, qui a inclus des frappes et une insertion de forces spéciales, a permis aux États-Unis d’appréhender le président vénézuélien et de l’exfiltrer vers le sol américain pour y faire face à des accusations fédérales.
La scène est dramatique. Un chef d’État en exercice a été neutralisé au cœur de sa capitale, extrait de force et conduit hors de son pays pour être jugé à New York. Ce n’est pas une simple arrestation judiciaire, mais une action militaire directe à l’encontre d’un dirigeant souverain, qui soulève des questions profondes sur le respect de la souveraineté des États et la légitimité du recours à la force sans mandat international clair.
C’est l’honneur d’un pays qui a été bafoué. Derrière cette opération, certains voient non seulement une démonstration de puissance, mais aussi une volonté d’affirmer une suprématie politique et économique sur une nation qui possède d’immenses ressources pétrolières.
Dans ce contexte, l’émotion internationale est vive : plusieurs voix diplomatiques et juridiques dénoncent une violation manifeste du droit international et des principes de la Charte des Nations unies. Des pays comme la Russie et des organisations régionales ont appelé à la libération de Maduro, estimant que ce type d’intervention constitue une ingérence inacceptable. La manière dont le président Maduro a été cuisiné en interne ne choque apparemment personne. Ici tout est question d’argent, d’opportunité et de positionnement. Pour en arriver à leur fin, une récompense record (jusqu’à 50 millions $) pour toute information menant à sa capture ou condamnation.
De quoi reproche-t-on à Maduro ?
L’administration américaine reproche à Nicolás Maduro son autoritarisme, la répression de l’opposition politique et la gestion d’une crise sociale et économique profonde au Venezuela. Les élections présidentielles de juillet 2024 ont été fortement contestées. L’opposition, appuyée par plusieurs pays, a dénoncé des fraudes électorales et l’absence de transparence dans la publication des résultats détaillés. Malgré ces contestations, Nicolás Maduro a été déclaré vainqueur dans un climat de forte défiance. En janvier 2025, il a prêté serment pour un troisième mandat, un scrutin déjà rejeté par une partie de la communauté internationale et par une large frange de l’opposition vénézuélienne.
Sur le plan judiciaire, Washington accuse Maduro de narcoterrorisme, de corruption et de collusion avec des organisations criminelles transnationales. Les autorités américaines affirment qu’il aurait dirigé ou protégé un vaste réseau de trafic de drogue impliquant des groupes armés et des cartels internationaux, avec pour objectif l’acheminement de cocaïne vers les États-Unis. Ces accusations incluent également des faits liés à l’utilisation d’armes lourdes et à des circuits de blanchiment d’argent au plus haut niveau de l’État.
C’est dans cette perspective que les États-Unis ont engagé des poursuites fédérales contre Nicolás Maduro, estimant que ses actions constituent une menace directe pour leur sécurité nationale. Cette démarche judiciaire, initiée depuis plusieurs années, marque une volonté américaine de faire comparaître un chef d’État en exercice devant ses tribunaux, en rupture assumée avec les usages classiques de la diplomatie internationale.
Drôle coïncidence historique
La doctrine militaire américaine en Amérique latine est limpide. À l’issue de la guerre froide, Washington s’est convaincu d’une chose essentielle : seule la puissance militaire permet de préserver la mythologie de l’hégémonie américaine. Pour y parvenir, les États-Unis entendent projeter et étendre leur puissance sur l’ensemble du continent américain, n’hésitant pas à affronter tout régime politique réfractaire à leur domination.
La crise panaméenne de 1989 en constitue une illustration parfaite. À chaque intervention, le même scénario se répète, les mêmes accusations sont brandies, le même champ lexical est mobilisé, y compris contre d’anciens alliés. Le cas du général Manuel Antonio Noriega est à cet égard révélateur.
Chef de facto du Panama dans les années 1980, Noriega est longtemps présenté comme « l’homme fort » du pays. Il convient pourtant de rappeler qu’il fut un collaborateur actif de la CIA. Mais l’allié d’hier devient progressivement l’ennemi à abattre dès lors qu’il cesse de servir les intérêts stratégiques de Washington.
Peu à peu, Noriega est qualifié de « problème stratégique ». Le contrôle du canal de Panama, enjeu géostratégique majeur, devient central. Les États-Unis accusent alors le régime panaméen de trafic de drogue en lien avec les cartels colombiens, de corruption massive et de répression politique. Le discours se durcit, la diabolisation s’installe.
Comme dans le cas du régime de Nicolás Maduro, le même champ lexical réapparaît. Washington, s’arrogeant un droit de vie et de mort sur les régimes politiques en Amérique latine, déclare frauduleuses les élections de mai 1989 au Panama. Dans cette logique, l’opération militaire américaine baptisée « Just Cause » est lancée le 20 décembre 1989, officiellement pour défendre la démocratie et lutter contre le narcotrafic.
Plus de 27 000 soldats américains sont alors déployés sur un territoire étranger. Une démonstration de force assumée, révélatrice d’une constante historique : lorsque le droit et la diplomatie s’épuisent, la puissance militaire prend le relais.
Pourquoi Moscou et Pékin n’ont-ils pas pris la défense de Caracas ?
De prime abord, il convient de préciser que nous ne sommes pas face à une occupation militaire classique ni à une invasion déclarée. Il s’agit plutôt d’une opération d’infiltration militaire soigneusement orchestrée, rapide et ciblée. Dans ce type de configuration, les marges de réaction des alliés sont extrêmement limitées.
Par ailleurs, la Russie et le Venezuela n’ont jamais signé de pacte militaire contraignant. Si tel avait été le cas, Moscou aurait été tenue d’intervenir, ne serait-ce que pour préserver sa crédibilité stratégique sur la scène internationale. Or, les relations russo-vénézuéliennes reposaient essentiellement sur des accords de coopération, notamment dans la formation des forces armées, la fourniture d’équipements militaires et le partage de renseignements.
Mais le mal était déjà profond. La chute du régime de Caracas ne s’est pas opérée uniquement de l’extérieur, elle s’est aussi jouée de l’intérieur. Des cadres de l’armée, des officiers supérieurs, voire des généraux, ont accepté de livrer leur propre chef d’État. Dès lors, que pouvait faire Moscou si les forces censées défendre les institutions avaient elles-mêmes renoncé à leur mission ? Aucun allié extérieur ne peut combattre à la place d’une armée qui choisit de ne pas se battre.
La diplomatie internationale ne prend réellement sens que lorsque deux puissances militaires comparables entrent en confrontation. Dans le cas contraire, elle reste largement déclarative. Les indignations, les communiqués et les protestations officielles n’annulent jamais un acte déjà posé. Les États-Unis, eux, sont habitués aux faits accomplis. Plus largement, l’Occident s’est régulièrement immiscé dans les affaires internes d’États souverains, souvent au mépris du droit international qu’il prétend défendre.
La vérité est brutale : la diplomatie internationale n’est pas faite pour les petites puissances militaires, encore moins pour les faibles. Cette lecture peut choquer les adeptes de la « morale internationale ». Ils diront, à juste titre, que l’administration Trump s’est livrée à une ingérence flagrante dans les affaires d’un État souverain et indépendant. Et ils n’auront pas tort.
Philosophiquement, ces âmes sensibles croient encore que la morale kantienne pourrait réguler le jeu diplomatique, au nom de l’équilibre mondial et du principe selon lequel il ne faudrait pas faire à autrui ce que l’on ne souhaiterait pas subir. Mais cette vision se heurte à la réalité crue des relations internationales.
Le principe est simple : soit vous imposez le jeu, soit vous le subissez. Les enjeux diplomatiques sont avant tout militaires, économiques, civilisationnels, religieux et désormais écologiques. Face à ces rapports de domination, la loi qui s’impose reste celle de la jungle : l’homme est un loup pour l’homme. Les civilisations s’affrontent, les idéologies et les religions s’y mêlent.
Dans ce schéma, les États-Unis occupent la première loge. Ils sont même capables de fabriquer des preuves lorsque cela sert leurs intérêts. L’exemple irakien reste gravé dans les mémoires. Sous l’administration de George W. Bush, le général américain et diplomate Colin Powell avait défendu devant la communauté internationale la thèse selon laquelle Saddam Hussein possédait des armes de destruction massive et entretenait des liens avec Al-Qaïda.
On connaît la suite. Le 13 décembre 2003, Saddam Hussein est arrêté près de Tikrit après huit mois de cavale. Il est capturé sans résistance dans un abri souterrain, mettant fin à l’une des chasses à l’homme les plus médiatisées du début des années 2000. Les armes de destruction massive, elles, ne seront jamais retrouvées.
Certaines puissances, comme la France, s’étaient opposées à cette guerre, même si le Royaume-Uni de Tony Blair avait choisi de s’aligner sur Washington. Entre les cas irakien, panaméen et vénézuélien, seules les formes et les contextes diffèrent. Le principe, lui, demeure immuable : la force prime sur le droit lorsque l’équilibre militaire est rompu.
La crise ivoirienne : la responsabilité historique de la France
Une autre épreuve de force, tout aussi révélatrice des mécanismes d’ingérence diplomatique et militaire, est l’intervention française en Côte d’Ivoire. Cette crise politique interne a opposé l’ex-président Laurent Gbagbo à l’actuel président Alassane Ouattara. Elle demeure l’une des plus sanglantes de l’histoire récente de l’Afrique de l’Ouest, avec plus de 3 000 morts recensés.
Les racines de cette crise sont profondes. En septembre 2002, une rébellion armée éclate, plongeant le pays dans une instabilité durable. La Côte d’Ivoire se retrouve alors coupée en deux : le Nord, contrôlé par les Forces nouvelles, et le Sud, resté sous l’autorité du président Laurent Gbagbo. Pendant près d’une décennie, le pays vit au rythme d’une crise politique, militaire et sociale sans précédent.
La crise postélectorale de 2010-2011 en constitue le point culminant. À l’issue d’un scrutin présidentiel controversé, les deux candidats se proclament vainqueurs. En dépit des mécanismes africains de médiation et des tentatives de règlement interne, la France, sous couvert de la « communauté internationale », choisit de s’engager ouvertement en faveur du candidat Alassane Ouattara.
À l’image de Washington dans d’autres théâtres d’opérations, Paris orchestre une intervention décisive. Une opération militaire ciblée est menée. Le président Laurent Gbagbo est arrêté dans sa résidence, puis transféré à la Cour pénale internationale. Une arrestation qui symbolise, pour beaucoup d’Africains, non pas l’aboutissement d’un processus judiciaire impartial, mais l’humiliation publique d’un chef d’État africain par une puissance étrangère.
Dès lors, le soutien affiché aujourd’hui de la France à la politique interventionniste de l’administration Trump ne surprend guère. Au nom d’une idéologie politique et civilisationnelle à géométrie variable, l’Occident s’arroge le droit d’intervenir, d’infiltrer les palais du tiers-monde et de décider du sort des dirigeants jugés indésirables.
Derrière le discours sur la démocratie et le droit international se cache une constante historique : lorsque les intérêts stratégiques sont en jeu, la souveraineté des États africains devient secondaire, et la force reprend ses droits.
L’Afrique doit travailler à se doter d’armes dissuasives
Depuis 1914, le monde vit dans un état de conflit militaire quasi permanent. Cette réalité tragique s’est imposée à l’humanité, révélant une constante inquiétante : le mal dominant ne trouve souvent sa tranquillité que dans la domination de l’autre. Cette observation met en lumière l’insociabilité fondamentale de l’homme, cette tendance à vouloir s’imposer à son voisin, quitte à l’écraser. C’est dans cette logique de domination continue que les civilisations dominantes ont imposé leurs systèmes de gouvernance, leurs valeurs et leurs règles.
Par ailleurs, la course effrénée à l’industrialisation a exacerbé cette concurrence sans limites. Ayant compris que les ressources disponibles ne suffisent pas à satisfaire l’ensemble de l’humanité, les grandes puissances ont intégré l’idée que le conflit est, sinon inévitable, du moins toujours possible. L’envie d’imposer sa loi, sa doctrine et son ordre du monde a toujours constitué le moteur des puissances hégémoniques. Il suffit d’observer l’évolution vertigineuse des budgets militaires à l’échelle mondiale pour saisir la profondeur de cette réalité.
La puissance militaire demeure un instrument central de dissuasion et, surtout, un facteur déterminant de respect sur la scène internationale. La Chine, la Russie, la Corée du Nord et certains pays du Golfe l’ont compris très tôt. Dans ce monde brutal, ce ne sont ni les discours ni les principes moraux qui garantissent la sécurité des États, mais bien leur capacité à dissuader toute agression.
Dès lors, une question fondamentale se pose : est-il juste que seules certaines puissances militaires et civilisationnelles détiennent des armes dissuasives capables, en un instant, de réduire le monde en cendres, pendant que d’autres nations demeurent structurellement vulnérables ?
Pour un monde plus équilibré, l’Afrique ne peut plus rester spectatrice. Sous la conduite de l’Union africaine, avec l’implication de ses scientifiques, de ses ingénieurs et de ses États, le continent doit réfléchir sérieusement à la maîtrise de technologies stratégiques à vocation dissuasive.
Seule une capacité militaire crédible et de haute intensité peut garantir une souveraineté réelle économique, politique et civilisationnelle. Dans un ordre international fondé sur la force, l’Afrique n’a plus le luxe de l’innocence.
Maxime Diassy
Journaliste-communicant
Maximediassy0@gmail.com
" "